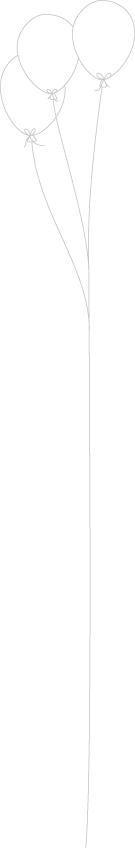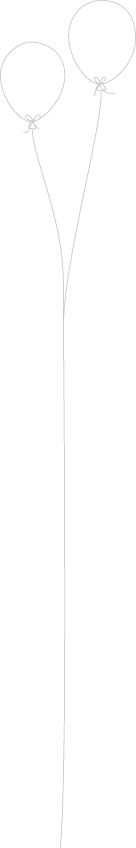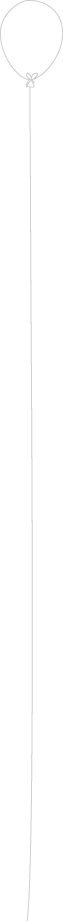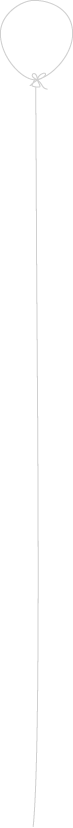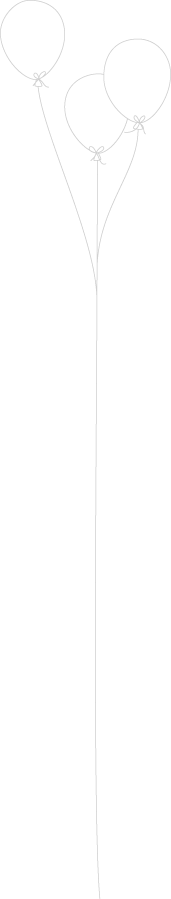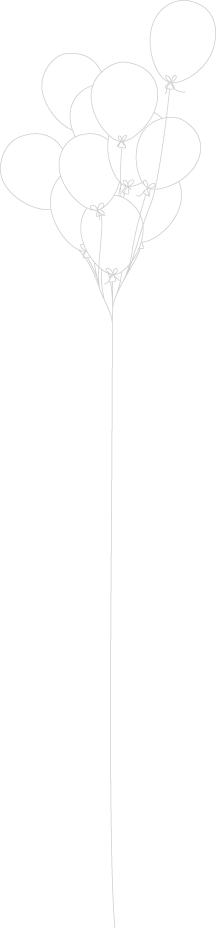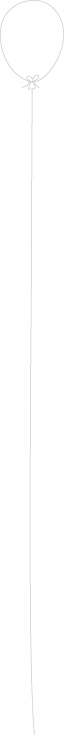Je termine la vie active de ce blogue avec une réponse à un billet d’un collègue, que l’on trouve ici : http://gabrielthibault.wordpress.com/2013/04/02/ping-pong-politique/. Attention à vos yeux : on y parle de politique, et qui dit politique dit désillusion, mensonges, mauvaise foi et cupidité. C’est drôle, parce qu’au même moment où je lisais ceci, la télé montrait les images de Justin Trudeau fraîchement élu, ses enfants dans ses bras et sa femme jouant son rôle comme il se doit, ô recueillement et émotion. Et que dire de son discours! Il représente exactement ce qui fait que politique rime avec pourriture.
Au-delà du discours de l’héritier, il n’y a pas grand-chose de frais et pur en politique. Le regard, le ton de la voix, la parcimonie victorieuse, le décor, le discours, les expressions, la modulation de la voix jusqu’à l’orgasme de la foule, les propos de ladite foule prise séparément au sortir de son orgasme, les idées véhiculées, les drapeaux agités…
Évidemment, on peut se dire que nous sommes chanceux d’avoir des élections libres et des maisons bien solides, avec des cours bien entretenues et des autos bien propres. Mais justement, il me semble que nous sommes assez hauts dans la pyramide de Maslow-version société pour être en mesure de pratiquer l’art politique de façon droite et bien intentionnée, non? Bien sûr, le mensonge et cie. sont corollaires au déploiement de l’humanité, alors bonne chance pour s’en débarrasser… N’empêche, c’est quand même frustrant qu’à cause de la puissance des groupuscules à qui le jeu politique croche profite, ledit jeu ne connaisse pas sa fin.
Mais que peut-on y faire? Selon ce que j’apprends dans un autre de mes cours, la participation au contre-pouvoir croît au même rythme que décroît celle aux élections. En gros, cela veut dire que bon nombre de personnes désillusionnées par les processus et résultats politiques traditionnels choisissent de se joindre à des groupes de pression, que ce soit des OSBL, des groupes communautaires, des associations, des comités, etc.
Est-ce suffisant? À mon avis, c’est extrêmement positif. Toutefois, la participation au contre-pouvoir nécessite autant de volonté et de dévouement que pour le pouvoir « vrai », c’est-à-dire beaucoup trop pour des personnes comme moi qui, pour toutes sortes de raison, ne désirent pas participer activement à de tels mouvements. Cela nous ramène à l’interrogation de base, soit : pourquoi les personnes qui ont l’énergie et la volonté de « faire bouger les choses » en politique cachent trop souvent qu’autrement de vilaines intentions sous leur volonté de fer? Je ne peux pas croire qu’intérêt pour la vie politique et tendances louches vont de pair. Pas pour tout le monde. Alors, c’est que les moins croches se laissent influencer et tenter par les plus croches, parce qu’ainsi va la vie, parce qu’on a tous des bouches à nourrir ou des pièces à redécorer.
Que fait-on alors? Puisque les plus croches régissent et contrôlent les actes des tout-aussi-croches, il est difficile d’imaginer des lendemains politiques plus angéliques. Je crois donc, comme mon collègue précédemment cité, que la solution passe par des idées innovatrices, qui, malheureusement, recueillent plus souvent qu’autrement des réactions apeurées, pépères, pessimistes. Voyons toutefois un exemple de solution fort intéressante proposée par mon collègue :
« Par exemple, si 3 partis ont chacun 2 personnes très qualifiées pour le poste de ministre de la Santé, au lieu de n’en prendre qu’un et de lui dire fait de ton mieux au pire dans 3 ans l’autre prendra ta place mettons les ensembles pour qu’ils trouvent des solutions ensembles.»
À mon avis, il faudrait que les systèmes électoraux du pays accueillent plus activement et plus favorablement les idées de personnes qui, sans vouloir devenir conseillers municipaux ou députés provinciaux, ont des bonnes idées, sorties d’on ne sait où, mais qui peuvent réellement changer les choses.
Étonnement, le seul milieu où j’ai entendu parler du genre de pratique consultative dont je rêve est le domaine minier, à cause de rencontres avec de fiers représentants de cette industrie qui, de prime abord, me rebute totalement. Ainsi, l’un de ces représentants, malgré son attitude cavalière franchement désagréable, racontait que la mine qui l’emploie a entre autres décidé de modifier les étapes de sa phase pré-exploitation afin d’y intégrer les recommandations, doléances et idées de génie des citoyens concernés par ses projets. Ils ont accepté de ralentir ce processus et de faire des retours en arrière pour mieux favoriser l’acceptabilité sociale de leurs projets. Cela peut sembler la moindre des choses, mais c’est beaucoup pour un domaine aussi réfractaire au gros bon sens. Il ne me vient pas à l’heure actuelle de souvenir précis des idées et propositions dont je parle, mais je me souviens avoir été franchement épatée par certaines des suggestions pas piquées des vers. On peut comparer cela à une situation plus près de nous : parfois, quand on a la tête pleine d’un travail sur lequel on peine depuis des jours, on n’est plus les mieux placés pour trouver la sortie du labyrinthe, pour trouver la pièce manquante ou le sens directeur que l’on a perdu.
Je crois donc que ce sens directeur, on l’a bel et bien perdu depuis bien avant le décès de Jack Layton, et je crois que les mieux placés pour sortir de ce labyrinthe plus-que-pourri, c’est nous.